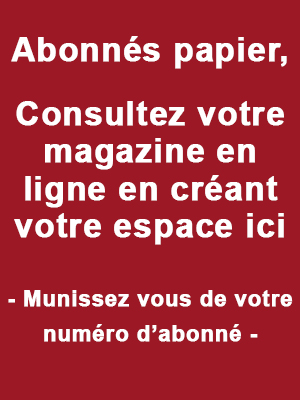N° 1259 | Le 15 octobre 2019 | Par Vincent Pallard, moniteur-éducateur en maison d’accueil spécialisée (Mas) | Échos du terrain (accès libre)
La parole constitue l’outil principal de l’éducateur. Pourtant, il existe des circonstances où son meilleur usage est d’y renoncer, le temps de laisser la place au silence.
Un jour, entre deux bouffées de cigarette, tu m’as dit que le silence en psychiatrie ça valait le plus grand des discours. À l’époque, je ne comprenais pas très bien ce que tu entendais par là car, dans ma tête, mes représentations foisonnaient tant qu’elles me laissaient à croire que le silence, c’était le Rien. Le Vide. Le Néant. La Mort même, dans son imprégnation symbolique. La mort des idées. La mort de l’échange, du partage. La mort du sens. Le silence, c’était lorsque l’on n’avait rien à se dire, lorsque l’on n’en avait rien à faire. C’était l’interstice d’une temporalité mise en suspend où plus rien ne se passe si ce n’est seul le Temps lui-même, et où tout devenait gênant, parce que l’on n’y maîtrisait plus grand-chose. Fort de mes a priori, je tentais face à ta souffrance de combler cette absence d’oralité par des phrases préconçues qui, pour tout t’avouer, ne rassuraient rétrospectivement que moi. C’est vrai quoi, qu’auraient fait ces autres, s’ils t’avaient entendu exprimer comme à moi la violence de ton verbe, sali par le tranchant de ta propre existence : « Je n’en peux plus, je voudrais mourir ! » ; « La vie n’a aucun sens, je voudrais qu’elle s’arrête ! », ou bien : « Regarde-moi, je patauge dans ma propre merde à plus de soixante ans ! » Mince, si je ne viens pas te dire qu’il y a encore de belles choses à tisser en ce monde, si moi, l’éducateur bien pensant, je ne viens pas interdire par la candeur de mes mots tes injonctions mortifères, si je ne viens pas remplir ce Rien qui risque de succéder à cet amoncellement de douleurs et d’angoisses, qui le fera, puisque la raison t’a si méchamment abandonné ? « Mais tais-toi, TAIS-TOI bon sang ! TAIS-TOI !!! », me rétorquais-tu, tandis que je m’efforçais de croire que la seule réponse à donner à ta peine était une succession interminable de particules syntaxiques qui te renvoyait à ton inexorable impossibilité d’y adhérer.
Et je continuais à te raconter l’histoire d’une vie dont j’ignorais l’issue, et dont je ne pouvais que fantasmer la poursuite. « Mais tais-toi s’il te plaît, mais tais-toi… », m’implorais-tu presque maintenant, priant pour que le silence me vienne, enfin. Quel mystère. Quel inconnu. Voilà que tu étais l’expéditeur d’un message dont tu refusais tout destinataire. Quelle ambivalence, mais quel paradoxe ! Quelle folie ! Là, assis dans la baignoire, recouvert de salive, d’urine et d’excréments, tu me criais et décriais la violence avec laquelle tu vivais l’injustice de ta situation ; tu dépeignais la réalité de l’instant avec un lexique des plus indigestes et dans la foulée, tu me demandais d’annuler mon souhait d’édulcorer ce dernier avec des mots plus arrondis, plus colorés, moins fatals. Diable, dans quelle position me mettais-tu…
Peu à peu, tu as doucement tenté de m’apprendre que, parfois, l’instantanéité du verbe est plus corrosive que cet après que l’on ne contrôle jamais vraiment. « Tu sais en psychiatrie, les gens causent, ça piaille, ça jacte, vous êtes doués pour ça. » Ça, c’était dans tes bons jours où, entre deux bouffées de cigarette, tu tentais sans t’en rendre compte de me donner les bons outils pour mieux accompagner ta propre parole. « Des fois, il n’y a rien à dire, mais il y a tout à faire. » « La vie, ce n’est pas du blabla, la vie, ça ne se contrôle pas. » Oui mais bon sang, pouvais-je te laisser avec cette sensation d’inéluctabilité si morbide, tandis que mon rôle était quand même bien de te véhiculer du désir de vivre, de projeter, de vouloir ? Toujours têtu, indécrottable éducateur, je notais tes propos sans en saisir le sens véritable. Car oui il y a bien du silence en psychiatrie. Mais était-ce vraiment celui dont tu me parlais ?

Au fur et à mesure que le Temps a passé, tu as peu à peu perdu tes moyens de disposer de la réalité telle que nous la percevions. Ce Temps, entité omniprésente, omnisciente, a peu à peu quitté ton champ de référence ; l’Être-là, lui, s’est fait nébuleux et ta capacité à te projeter dans un après s’est faite peu à peu vaine, car, dès l’instant où le présent se mêlait avec le nulle part ailleurs, l’avenir a peu à peu cessé de prendre sens chez toi. « J’en ai marre, je n’en peux plus de cette vie », me répétais-tu encore. Et moi je restais là, ébahi par l’injustice qui assaillait ta légitimité à vivre dignement. Et de temps en temps la réalité te rattrapait de plein fouet et me nouait la gorge : « J’ai soixante ans et je vis dans ma pisse, je dors, je bouffe. » « J’ai peur de l’hiver, je suis trop faible, je n’y arriverai pas. » Voilà que je me glissais doucement mais pas moins inévitablement dans ce drap silencieux, non pas résigné, mais à court de mots. Et c’est à ce moment qu’un tout nouveau langage s’est imposé à moi. On a tendance à croire que c’est via la parole que vont se jouer les miracles de la relation éducative. Encore une fois, la parole rassure celui qui la profère. Elle vient matérialiser ce qu’il y a de parfois le plus inatteignable. En vain. À tort. Je l’ignore. Pour autant, lorsque tu m’as étalé ton trop-plein de ras-le-bol de cette vie qui t’a si souvent molesté, c’est lorsque les mots m’ont fait défaut que tu m’as le plus souvent répondu… À ne point répondre, je légitimais dès lors ta souffrance, cet Être là si douloureux ; je ne le court-circuitais pas de palabres infinitésimalement surfaits, non… Je lâchais prise. Et si à cet instant tu pensais fervemment que ta vie était dégueulasse, alors soit. Que la vie soit dégueulasse. Qu’elle soit vile, douloureuse, injuste. Que la vie soit chienne, car, après tout, toi seul est le mieux placé pour m’en narrer la profondeur. Moi, je n’ai que la mienne comme point de référence, et comparer mon existence à la tienne n’est pas synonyme d’empathie. L’empathie, c’est cette faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui. Et si je veux me mettre à ta place, je dois inexorablement abandonner mon champ de certitudes. Et face à ta réalité, c’est vrai, sur le moment, il n’y a rien à dire. Alors j’ai fini par ne plus rien dire… Et dans ce silence, auparavant si anxiogène, pour moi surtout, se nichait alors un amoncellement de réponses jusqu’alors insoupçonnées. « J’en ai marre de la vie » ; « Je n’en peux plus de continuer comme ça. »
En silence, puis une main tendue, et c’est bientôt l’épaule qui se fait tutrice. Non, je ne dis plus rien en ce moment où tu n’es plus capable d’entendre ces longs sermons interminablement indigestes sur une vie que tu ne connaîtras peut-être jamais. Je te prête ma main, mes bras, mes oreilles bien sûr. Mais mes lèvres, elles, restent scellées face à ce que je ne peux concevoir. Et soudain, te voilà réceptif. Ma main rencontre la tienne sans heurt et sans rejet ; mon épaule essuie tes larmes, ta salive, et tandis que nous nous trouvons tous deux dans cette salle de bains, toi immergé jusqu’au torse et moi par ta souffrance, j’étouffe un « Je suis là, tu n’es pas seul ». Puis je me tais. Je fais silence. Tu le fais aussi. Et c’est main dans la main que nos réponses s’entrecroisent, enrubannées par la force de l’humilité du moment. J’accepte ton désespoir et tu acceptes mon impuissance. De là naît l’absence de mots, si superficiels, car face à une main tendue, une épaule de prêtée et la possibilité de différer nos verbes, les mots et les phrases à dire et à parler prennent leur sens là où on ne les y attendait pas. Dans l’après. Car dans l’instant, rien ne compte plus que le silence. « Le silence a le poids des larmes », disait Louis Aragon…