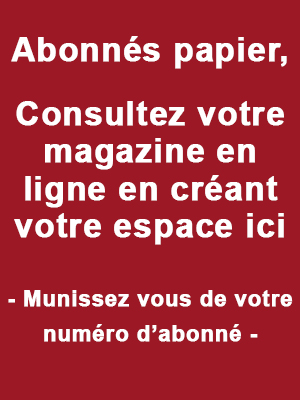N° 1341 | Le 1er juin 2023 | Par Dare | Espace du lecteur (accès libre)
Le monde socio-judicaire, à l’instar des autres secteurs professionnels, ne semble pas exempt de dysfonctionnements. Témoignage.
J’ai profité du confinement en 2020 pour rechercher un métier utile et éloigné de la recherche de bénéfices. Intervenante socio-judiciaire dans une association, je pouvais aller sur le terrain, être au contact direct d’un public difficile et mener des accompagnements approfondis.
Mais la réalité est trompeuse et même violente à vivre : les conditions de travail sont aux antipodes des valeurs défendues, telles que celles de l’humanité, avec pour objectifs sous-jacents le rendement et la rentabilité. Comme ailleurs, la direction fait « tourner la boutique » à un moindre coût : nombre de dossiers priorisé sur la qualité du travail, énorme pression pour respecter les délais et recrutement de personnes non encore diplômées ou stagiaires. En bref, les salariés ne sont que de simples exécutants et sont tenus responsables de la viabilité du service.
Il existe une souffrance latente au sein du monde socio-judiciaire, un manque d’humanisme et de reconnaissance à l’égard des personnes placées sous main de justice et des professionnels, passionnés et investis.
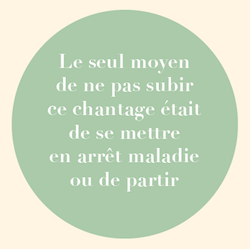 Dès mes débuts, je me suis sentie dans mon élément et accueillie par mes collègues. J’avais pour mission de contrôler strictement le respect d’obligations et d’interdictions judiciaires par des personnes prévenues ou accusées d’avoir commis une infraction, et de m’attarder sur leurs problématiques personnelles, pour justifier ensuite de l’évolution de leur situation au juge. Au-delà de mon profil de juriste, je devais être psychologue, assistante de service social et conseillère en insertion professionnelle, sans pour autant en avoir les diplômes. J’ai ainsi été plongée dans le bain sans même suivre de formation et ai très vite été confrontée au manque de communication et de considération de ma hiérarchie. La direction nous interdisait formellement de prendre directement attache avec elle, nous devions uniquement passer par notre supérieur direct. Cela a d’ailleurs entraîné plusieurs démissions.
Dès mes débuts, je me suis sentie dans mon élément et accueillie par mes collègues. J’avais pour mission de contrôler strictement le respect d’obligations et d’interdictions judiciaires par des personnes prévenues ou accusées d’avoir commis une infraction, et de m’attarder sur leurs problématiques personnelles, pour justifier ensuite de l’évolution de leur situation au juge. Au-delà de mon profil de juriste, je devais être psychologue, assistante de service social et conseillère en insertion professionnelle, sans pour autant en avoir les diplômes. J’ai ainsi été plongée dans le bain sans même suivre de formation et ai très vite été confrontée au manque de communication et de considération de ma hiérarchie. La direction nous interdisait formellement de prendre directement attache avec elle, nous devions uniquement passer par notre supérieur direct. Cela a d’ailleurs entraîné plusieurs démissions.
En plein cœur d’une pandémie sanitaire, le télétravail, largement dénigré, a mis longtemps à être mis en place et de manière strictement encadrée avec des moyens limités : roulement imposé pour utiliser les ordinateurs professionnels et entretiens menés avec nos propres mobiles, en numéros masqués.
Une nouvelle directrice de pôle, de type gestionnaire, a finalement été recrutée pour « serrer la vis » : son but était d’augmenter le nombre de mesures et de rationaliser le temps de travail. Elle appliquait les ordres de la hiérarchie sans se soucier de l’impact de ses décisions sur les personnes accompagnées.
À regret, je décidais de quitter mes fonctions dans cette institution, tout en essayant de les poursuivre dans une autre… De la même manière, j’ai là encore, été profondément atteinte par la pression exercée sur les salariés et la politique du chiffre mise en place. Recrutée comme enquêtrice de personnalité, je découvrais un nouveau rôle de témoin de l’histoire de vie de personnes mises en examen : je devais les rencontrer en détention ou à domicile, puis compléter leurs propos auprès de leur entourage. Je ressentais une certaine frustration dès lors qu’il n’y avait plus aucun accompagnement sur le court/moyen terme. En clair, nous ne revoyions la personne que si son renvoi en cour d’assises avait lieu. Aussi ce métier était bien plus rythmé d’aléas que le précédent, et aucun n’était pris en compte par la hiérarchie : nous avions des objectifs fixés à l’avance et devions les réaliser en un temps imparti. Pourtant, les enquêtes que nous recevions pouvaient parfois déjà avoir un an de retard de traitement.
Pour la direction, le principe était simple : il fallait accepter tous les dossiers transmis par les tribunaux sans exception, afin de faire preuve de sérieux, s’imposer face à la concurrence, avoir du travail et pouvoir payer le personnel. Sans aucune concertation, la charge de travail augmentait au fur et à mesure du temps de poste. Notre utilité première était de rapporter de l’argent, alors même que les salaires y sont totalement dérisoires, notamment comparés au niveau d’études attendu.
Finalement, soit nous ne réussissions pas à respecter les objectifs, soit nous étions obligés de faire des heures supplémentaires non rémunérées mais rattrapées, que la charge de travail ne nous permettait nullement de poser. J’ai très vite su que les salariés n’étaient que de passage dans cette
 structure. En un an et demi, une quinzaine de départs ont eu lieu. Pour la direction, ce turn-over s’expliquait simplement par le coût de la vie ; pour elle, les objectifs étaient réalisables dès lors que nous ne nous attardions pas sur les détails et limitions les temps d’entretien. Selon elle, notre incapacité à respecter les délais expliquait le déficit financier existant. L’atmosphère était lourde dans nos locaux et la souffrance de mes collègues m’atteignait fortement. Je me sentais coupable lorsque je prenais une petite pause ou que j’échangeais avec eux, craignant le risque de prendre du retard. Nous en étions au point de nous satisfaire d’avoir en entretien des personnes peu prolixes car cela nous permettait d’aller plus vite ! Lors d’un énième coup de pression, je revendiquais que l’humain ne pouvait être réduit à des chiffres et que nous participions à l’individualisation de la réponse pénale. Mais au bout du compte, c’était à moi de me préserver et de savoir mesurer mon investissement.
structure. En un an et demi, une quinzaine de départs ont eu lieu. Pour la direction, ce turn-over s’expliquait simplement par le coût de la vie ; pour elle, les objectifs étaient réalisables dès lors que nous ne nous attardions pas sur les détails et limitions les temps d’entretien. Selon elle, notre incapacité à respecter les délais expliquait le déficit financier existant. L’atmosphère était lourde dans nos locaux et la souffrance de mes collègues m’atteignait fortement. Je me sentais coupable lorsque je prenais une petite pause ou que j’échangeais avec eux, craignant le risque de prendre du retard. Nous en étions au point de nous satisfaire d’avoir en entretien des personnes peu prolixes car cela nous permettait d’aller plus vite ! Lors d’un énième coup de pression, je revendiquais que l’humain ne pouvait être réduit à des chiffres et que nous participions à l’individualisation de la réponse pénale. Mais au bout du compte, c’était à moi de me préserver et de savoir mesurer mon investissement.
La direction a continué à instaurer encore plus de contrôles et de règles : à tout moment, nous pouvions nous voir reporter ou annuler nos congés, être interdits de télétravail jusqu’à ce que notre retard soit résorbé, etc. Nous devions prouver notre rentabilité pour ne pas risquer d’être licenciés. Le seul moyen qu’il restait de ne pas subir ce chantage et de ne pas tomber dans un « burn-out », était de se mettre en arrêt maladie ou de partir. J’ai ainsi dû prendre la décision de renoncer à ce métier passionnant.
Mes deux derniers jours après deux semaines d’arrêt furent sans appel : aucune des personnes que j’avais convoquées pendant ce laps de temps n’avait été informée de mon absence ; ce n’est qu’au moment même du rendez-vous qu’on le leur avait signalé. En bref, il n’y avait eu aucune continuité de service : mes suivis avaient été mis entre parenthèses, mes rapports déjà préparés n’avaient pas été envoyés aux juges, et donc des audiences avaient eu lieu, des verdicts avaient été rendus, sans nullement tenir compte du déroulé de la mesure. Par ailleurs, on attendait de moi que je clôture les objectifs qui m’avaient été fixés, pendant que je ne pensais qu’à appeler les différentes personnes pour m’excuser de cette mauvaise organisation. Au moment de partir, je n’ai eu aucun au revoir, comme si j’allais revenir les jours suivants. Le lendemain matin de mon départ, toute trace de ma présence avait été supprimée, comme si je n’avais jamais existé.
Intégrer le monde socio-judiciaire était une concrétisation de mon désir le plus profond d’œuvrer pour la justice, d’être au plus près d’une population totalement reléguée et en souffrance malgré tout. Depuis les années 2000, l’État a choisi de déléguer une partie de la justice aux associations mais l’humain y est réduit à l’appât du gain et à la politique du chiffre. Face à un tel manque de reconnaissance la question est de savoir de quelle façon les subventions étatiques sont attribuées et l’argent public utilisé ? Comment peut-on se targuer de prévenir la délinquance dans ces conditions ?
Il faut sortir du silence et de l’ignorance de ce monde socio-judiciaire qui n’assume que partiellement les responsabilités qui lui incombent.
Lecteurs à vos plumes ! Une adresse : red@lien-social.com