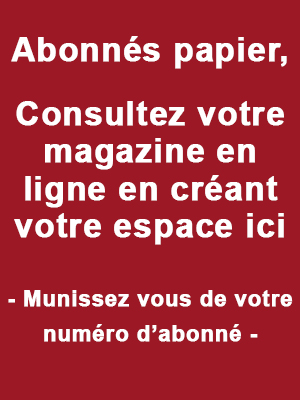« LE CARNET DE ROUTE D’UN(E) MIGRANT(E) » UN PROJET PÉDAGOGIQUE ALTERNATIF (2)
 PÔLE FORMATION & RECHERCHE
PÔLE FORMATION & RECHERCHE
Institut Saint-Simon
Par Fatna BELGACEM, Formatrice sur le site d’Albi
Formatrice auprès des futur(e)s éducateur(trice)s spécialisé(e)s à l’Institut Saint-Simon - Arseaa (organisme de formation en Travail Social), j’ai dû, en raison de la crise sanitaire et du confinement, m’adapter à de nouvelles modalités pédagogiques de formation à distance.
Afin de ne pas coller au schéma classique de la transmission descendante du savoir, avec des cours magistraux parfois trop théoriques, j’ai souhaité mettre en œuvre une pédagogie active.
Ainsi, pour permettre aux étudiant(e)s de travailler sur la thématique des droits des migrant(e)s, plus précisément autour des représentations des statuts des étranger(ère)s (sans papiers, demandeurs d’asile, réfugié[e]s…), j’ai inventé et proposé une démarche différente à travers une projet de travail collectif intitulé « Le carnet de route d’un(e) migrant(e) ».
Les étudiant(e)s et apprenti(e)s de première année de la promotion 2019-2022 du site d’Albi ont se sont prêté(e)s à cet exercice pédagogique ; je les en remercie. Par groupes de quatre ou cinq, ils (elles) durent imaginer puis écrire en détail le parcours migratoire d’une personne à la recherche d’une terre d’accueil, en décrivant son profil, en indiquant les causes de son départ de son pays d’origine, en racontant les étapes et les péripéties de son parcours, en indiquant les moyens de transport utilisés, en précisant les conditions de son arrivée en France ou dans un autre pays Européen, etc…
Afin de produire son exercice, chaque groupe devait s’appuyer sur des textes internationaux, européens et nationaux pour défendre les droits des personnes qui demanderaient l’asile et, donc le statut de réfugié. Chaque groupe devait également prendre en considération les dispositifs humanitaires existants pour accueillir les personnes migrantes.
À l’issue de ce travail écrit, une restitution orale a été réalisée devant l’ensemble de la promotion. La diversité des récits à la fois fictifs et réalistes présentés pendant environ vingt minutes a permis à l’ensemble des apprenant(e)s d’entrevoir combien les parcours migratoires s’apparentent souvent – sinon toujours – à de véritables « parcours du combattant », et que les lois, hélas, ne protègent pas systématiquement les personnes migrantes.
À travers cet exercice qui comporte une dimension ludique, plusieurs objectifs sérieux étaient visés : travailler en groupe ; travailler les représentations individuelles et collectives ; identifier et exploiter des ressources pertinentes ; être à la fois imaginatif et réaliste ; acquérir des connaissances à propos des droits des migrant(e)s, des systèmes frontaliers, des textes législatifs ; expérimenter l’écriture collective ; restituer son travail à l’oral.
En lisant les écrits des étudiant(e)s, à la fois créatifs, de bonne facture et qui renvoient à ce qu’il y a de plus profond dans l’humain, j’ai pensé qu’ils méritaient d’être partagés. Dans une volonté de valoriser leur travail, j’ai alors pensé à Lien Social, qui a répondu favorablement…
Au sein de notre organisme de formation, ce travail sera mis en perspective dans la cadre de conférences auxquelles nous commençons à réfléchir avec les étudiants.
Par Emilie Vidal, Elise Guybert, Zélie Mobian, Auriane Liénard
Fuir la Syrie en guerre

Je vivais à Alep. J’avais 17 ans. Notre quotidien était rythmé par les bombardements, la violence, la mort. Je vivais avec mon père, ma mère et deux de mes petits frères, dans une petite bicoque en ruine. Mes deux grands frères étaient déjà partis à la poursuite d’un rêve occidental depuis presque deux ans. Nous étions sans nouvelle d’eux depuis, mais ils étaient évoqués en héros, en sauveur. Mon père disait souvent que s’ils ne donnaient pas de nouvelle, c’est qu’ils travaillaient dur pour pouvoir nous envoyer de quoi vivre une vie meilleure, et fuir dans les campagnes.
C’était le 4 avril 2016. Je m’en souviens, j’entends encore les bruits des bombardements plus proches encore que d’habitude. Je revois les flammes, les détonations, les corps inertes de mes parents. C’était le 4 avril 2016 et j’ai perdu les êtres les plus chers de mon existence. Je me suis retrouvée à la rue, avec mes deux petits frères, 8 et 10 ans. Je me suis battue pour continuer à les faire manger, au moins un peu, pour continuer à nous maintenir en vie. Un oncle nous a beaucoup aidé je me souviens.
Et puis j’ai rencontré Leila. Elle était grande, belle. Elle s’habillait bien et elle portait toujours des boucles d’oreille, je me souviens. Elle parlait bien et elle connaissait beaucoup de choses. Une bulle d’oxygène dans ce quotidien si rude. Elle m’a aidée à nous cacher, à nous trouver un semblant de toit, à manger. Elle parlait beaucoup de l’occident, de la France surtout, je me souviens… Elle me disait que là-bas, il est plus facile de trouver du travail et que les maisons sont belles, grandes et qu’elles ne sont pas toutes démolies. J’en rêvais la nuit, j’alimentais de ces anecdotes les histoires que je racontais à mes frères. Je leur promettais qu’un jour, nous aussi, nous y irions, nous aussi nous rejoindrions nos aînés.
Un jour, elle m’a proposé de partir. Elle avait une super opportunité pour moi : des grandes chaînes d’hôtel françaises employaient des jeunes femmes pour aider à l’entretien des locaux. C’était bien payé, ça pouvait m’aider à récolter les fonds pour permettre à mes petits frères d’un jour me rejoindre. Les questions ne manquaient pas… Comment j’allais pouvoir faire pour aller jusqu’en France ? Qui allait s’occuper de mes petits frères ? Là encore, Leïla s’est montrée très prévenante, rassurante. Pour les sous je n’avais pas à m’inquiéter, elle m’aiderait et je pourrais commencer à travailler pendant les différentes étapes du voyage. Pour mes frères, elle avait un ami qui s’occuperait d’eux, dans les abords d’Alep.
Je suis partie en 2018. Leïla m’a présentée un groupe de jeunes filles d’à peu près mon âge, qui partait à mes côtés, dans la poursuite du même idéal. Elle nous a présenté un homme, Bassem je crois. Il nous a expliqué qu’il ne nous faisait pas payer le voyage jusqu’en Turquie, à condition que l’on travaille six mois pour lui là-bas, avant qu’il ne nous aide à continuer notre parcours. C’était le prix à payer pour accéder à notre rêve occidental. On a accepté.
Juin 2018. Arrivées à Istanbul. Ici, la prostitution est légale, mais uniquement au sein de maisons closes. Nous avons très vite compris que nous n’étions pas là pour faire des ménages. Après quelques brèves explications, Bassem nous a laissées entre les mains de plusieurs hommes, qui nous ont dispatchées dans toute la ville. Le message était clair, nous devions ramener un minimum de 50 livres turques par jour, sinon quoi, nous ne pouvions pas rentrer le soir. Rentrer dans un petit appartement, où nous vivions à 12 dans une petite pièce à vivre, sans intimité aucune. Certains soirs, des hommes, des inconnus, venaient et nous battaient, exigeaient des passes sans contrepartie financière. Bassem restait là, sans rien dire et saluait les hommes à leur départ. Nous ne mangions qu’un peu, un repas par jour, et encore. Nous multiplions les passes. Une passe ne devait pas dépasser 7 livres turques, et nous devions donc les enchaîner pour parvenir à atteindre les objectifs de Bassem.
Ça a duré presque 9 mois. 9 mois de peur. Peur d’une grossesse, peur que ça ne s’arrête jamais, peur que mon rêve d’occident soit anéanti pour toujours. Un jour, j’ai entrevu la porte de sortie. Un client, qui venait me voir régulièrement, m’a parlé d’un contact à lui qui permettait à des gens dans ma situation de quitter la Turquie. Pleine d’espoir, je me suis mise à augmenter le nombre de passes, et à ne pas tout reverser à Bassem, pour mettre de côté et ainsi partir à son insu.
C’était le jour J, après avoir rencontré le passeur Talal par le biais d’un client régulier, j’allais enfin sortir de ce réseau qui me faisait de plus en plus souffrir. Mais j’avais peur. J’étais au courant que si on m’arrêtait alors que je tentais de rejoindre la Grèce, c’était retour à la case départ pour moi et retourner à Istanbul me terrifiait. Je n’ose même pas imaginer ce que Bassem m’aurait fait s’il m’avait retrouvée. Quitter la Turquie n’était pas une mince affaire, Bassem nous avait prévenu : l’UE apporte son soutien financier à la Turquie en échange de quoi cette dernière limite de beaucoup la perméabilité de ses frontières... Le trajet est loin dans mon esprit, peu de souvenirs me parviennent… Je me souviens de longues heures d’incertitude, de la faim, de la soif.
Arrivée en Grèce, je me suis rapidement retrouvée dans un camp avec d’autres migrants. Je vivais sous une petite tente qui ne me protégeait pas du froid. J’avais faim et pas accès à l’eau potable mais je suis restée là-bas plusieurs semaines. J’ai pu rencontrer Hasnaa qui avait le même rêve que moi. Ensemble, nous avons quitté le camp pour nous rendre en Italie. Mais là aussi, il fallait payer. J’ai donné mes toutes dernières économies au passeur pour faire le trajet en bateau. C’était plutôt un pneumatique sur lequel nous étions une centaine. Des enfants, des bébés. J’ai eu peur pour ma vie et j’ai prié tout le long mais nous avons réussi à rejoindre la côte. Nous sommes arrivés à Lecce, une petite ville au sud de l’Italie.

Nous avons été interceptés dans les eaux italiennes, alors que notre embarcation menaçait de virer de bord. Une fois à terre, plusieurs visages ont défilé. J’étais désorientées, mes souvenirs sont vagues. Il me semble qu’il y avait des soignants, avec une croix rouge sur des brassards et sur leur veste, des policiers aussi …
Aujourd’hui, je suis bloquée en Italie, menacée d’expulsion, en attente d’une réponse concernant ma demande du statut de réfugiée… Les associations et nos différents interlocuteurs nous ont déconseillé de partir. Ils nous ont parlé d’un règlement, le règlement de Dublin. Ils nous disent qu’à cause de cette loi, on ne peut plus partir, parce que les autorités ici ont déjà nos empreintes et qu’ainsi, partout où elles seront prises ailleurs, on nous renverra en Italie… Heureusement, ici, malgré la loi anti-immigration de 2018, des associations se battent pour qu’on nous accueille dignement, nous les migrants. Aujourd’hui, je suis hébergée dans le centre d’accueil de Macurano, plus au Sud de l’Italie, et j’apprends l’italien, pour mettre toutes les chances de mon côté. C’est d’ici, entre ces murs, que j’ai pu écrire ces lignes pour conter mon histoire, dans ce petit carnet qui ne me quittera pas pour la suite de mon périple… Je tenterai coûte que coûte de rejoindre la France, réaliser mon rêve pour offrir un avenir à mes frères.