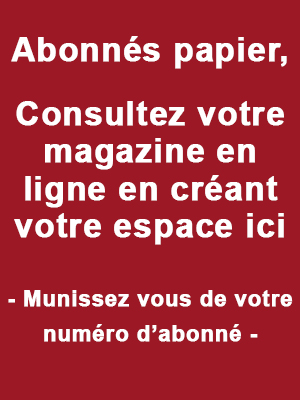Guyane : le travail social à la peine
À 7 000 km de Paris, la Guyane est à l’abandon. Depuis le 20 mars, ce département français d’Amérique du sud vit au rythme des barricades, puis d’une grève générale entamée le 27 mars. Environ 250 000 habitants se répartissent sur un territoire équivalent au Portugal, dont plus de la moitié est inaccessible par voie terrestre. Près de 45 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté, fixé ici à 500 euros. Le taux de chômage a été évalué à 22 % en 2015 par l’Insee, atteignant 54,9 % pour les moins de 25 ans. Après son passage en octobre 2016, le Défenseur des droits dresse un portrait criant d’inégalité : 15 % à 20 % de la population ne bénéficie pas des infrastructures élémentaires (eau potable, électricité, téléphone, logement), le décrochage scolaire est trois fois supérieur à la métropole (9 % des élèves quittent l’école avant la classe de 3ème), et le taux de suicide y est 20 fois supérieur.
Errance, déscolarisation, violence
Face à cette situation, les travailleurs sociaux sont en première ligne… mais complètement désarmés. « Dans la région de Saint-Laurent du Maroni, à l’ouest, seulement deux éducateurs de l’ASE sont présents pour 44 000 habitants, dont 15 000 de moins de 20 ans, explique une travailleuse sociale en poste depuis 10 ans en Guyane. Les familles d’accueil reçoivent 8 ou 9 enfants. Nous signalons des problématiques d’errance, de déscolarisation, de violence, de toxicomanie sans qu’aucune décision ne soit prise parce qu’il n’y pas de réponse institutionnelle. Les juges ne font plus d’Aide éducative en milieu ouvert (AEMO) parce qu’il n’y a pas de professionnels pour assurer les suivis. À la maison des adolescents, un éducateur, une assistante sociale et un psychologue assurent le suivi de 300 ados et 60 parents. On attend juste de ce mouvement social d’obtenir les mêmes droits qu’en métropole ».
Pas de droit, pas de respect de la loi
Si les « 500 frères » font de la lutte contre l’insécurité le levier de ce mouvement social, les travailleurs sociaux dénoncent d’autres violences : une justice qui ferme les yeux quand une jeune fille de 18 ans accouche de son quatrième enfant, un CHRS destiné aux femmes victimes de violences mais qui refuse les mères de plus de trois enfants ou un enfant de moins de 3 ans, à Saint-Laurent, un centre médico psychologique infantile qui ne compte qu’un psychiatre. Et chaque année, 150 élèves mis au ban de l’éducation nationale à l’issue de la 3ème parce qu’il n’y a plus de places en lycée. « Quand on n’a pas de droit, il n’y a aucune raison de respecter la loi, souligne la travailleuse sociale. Les jeunes ne sont pas plus violents qu’ailleurs, ils répondent à une violence institutionnelle ».