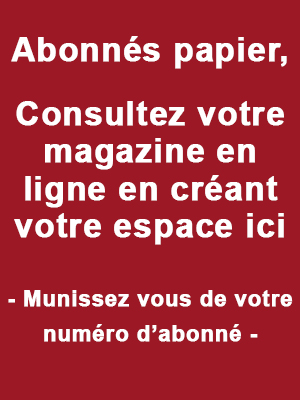N° 1245 | Le 19 février 2019 | par Lucie Masson-Chabba, éducatrice spécialisée | Espace du lecteur (accès libre)
Combien de fois ai-je entendu des éducs prononcer ces mots : « Je voudrais faire une reconversion, mais je ne sais pas en quoi… » Moi, personnellement, j’aimerais me reconvertir en chat, faire la feignasse tout le jour et traîner la nuit, mais quelqu’un m’a dit que ce n’était pas possible. Plus sérieusement, c’est terrible, cette crise de la reconversion, n’est-ce pas ? Nous avons suivi une formation durant trois années (deux reconnues – cela fait très peu de temps qu’on reconnaît la formation à sa juste valeur) aussi diversifiée que passionnante, nous avons été diplômés, c’était une fierté. Nous n’imaginions pas faire autre chose, c’était ça notre métier. Et je m’entends dire, naïve comme j’étais : « Je pourrai travailler avec plein de publics différents, il n’y aura jamais d’usure professionnelle ». Faux ! Tu commences dans un domaine et tu y restes ! Éduc, c’est un peu comme un métier de la télé, on te colle des étiquettes… Quand tu es animateur de Touche pas à mon poste, on t’imagine mal présenter le 20 heures sur France 2. Eh bien nous, c’est un peu pareil ! Lorsqu’on se fait dix ans dans l’insertion par le logement, on ne t’imagine pas auprès d’enfants en IME.
On fait partie des rares boulots où, si l’on veut progresser, il faut accepter de perdre en salaire (changement de convention, non reprise de l’ancienneté). Attention, lorsque je dis « progresser » j’entends évoluer, pas forcément monter dans l’organigramme. En effet, à mon sens, l’évolution n’est pas que promotion. Nous avons le droit de ne pas vouloir prendre l’escalier, pour aller dans les étages, on peut aussi souhaiter changer de bâtiment. Mais, dans le bâtiment d’à côté, on ne reconnaît pas souvent que tu as travaillé avant, ailleurs, et que tu as acquis des compétences, un savoir-faire, un savoir-être. On ne cherche pas de personnes qualifiées, compétentes, expérimentées, on recherche des salariés pas chers.
Pour en revenir à ce désir, à cette volonté, à ce besoin de faire autre chose, d’où vient-il ? Quel est le mal qui nous a piqués, nous les éducs de dix ans et plus ?
Est-ce vraiment à cause de notre travail, et que de notre travail ? « Pourtant vous avez vachement plus de vacances que les autres »… mais ta gueule ! Pour une part, je dirais que oui. Accompagner, soutenir, écouter, rassurer, demande une énergie certaine, mais que nous n’avons pas toujours, en tout cas pas tous les jours.
Je dois reconnaître que parfois, à 9 heures, dans mon bureau fermé, l’odeur de tabac froid et l’haleine éthylique me fout un peu la gerbe. Je ne serais pas contre un petit stage en parfumerie. Je dois reconnaître que parfois, lorsque je vais à domicile dans un appartement encombré de détritus et autres légumes pourris gisants sur le sol (« Ah bah, tu vois, je t’avais bien dit que les pauvres mangeaient quand même des légumes ») j’aimerais être agent immobilier sur M6. Je dois reconnaître que lorsque je remplis une demande de logement pour un F6 sur une grande métropole, j’aimerais être une fée dotée d’une baguette magique. Oui, parfois, mon travail me fatigue.
Mais sachez qu’il n’y a pas que ça. Les conditions de travail me fatiguent, pire elles me découragent. « Ah bah, ça y est, on y vient, la grognasse se plaint, qu’elle aille bosser en Inde, elle la ramènera moins ! » En 2012, j’accompagnais une vingtaine de personnes/familles, cela pouvait aller jusqu’à 25. Aujourd’hui, j’accompagne 50 personnes/familles, sans que cela semble choquer quiconque. Lorsque je vois des collègues dévalué·es, non reconnu·es, nié·es, je perd espoir. Lorsque j’observe des professionnels fuir ce champ du social parce qu’ils ne résistent plus aux pressions, je m’incline et je pleure.
Dans la phrase : « Je voudrais faire une reconversion », il faut entendre Je suis épuisé·e, je ne suis pas soutenu·e. Combien de fois entendons-nous « C’est un beau métier, moi je ne pourrais pas le faire. » Oui c’est un beau métier, mais nous manquons cruellement de reconnaissance. La mobilité professionnelle est quasi inexistante. Nos conditions de travail se dégradent, et si nous ne sommes pas content·es. nous n’avons qu’à partir ! Mais partir où ? Les postes à pourvoir sont les remplacements de collègues qui n’ont eu d’autre choix que de jeter l’éponge, dans des institutions en crise. En attendant les professionnels s’épuisent, les personnes continuent à se précariser. Nombreuses sont celles laissées sur le bas-côté. Je crois que ce qui est le plus insupportable pour un travailleur social ; c’est de ne pouvoir réaliser la mission pour laquelle il a été embauché. On ne fait pas ce métier pour l’argent, nous le savons tous, on le fait par conviction, on le fait par humanisme, mais lorsque nos associations deviennent des entreprises du social, des pantins animés par les budgets, alors l’humanité s’éteint. Quel professionnel n’a pas entendu qu’il faisait de la résistance au changement ? Résister à l’appauvrissement de notre métier, résister à l’accroissement des inégalités, c’est peut-être résister au changement, en effet…
Si nous voulons partir, c’est pour ne plus cautionner. Si nous voulons partir, c’est parce qu’en dix ans tout a chaviré. Si nous nous partons, c’est parce qu’on ne nous retient pas…